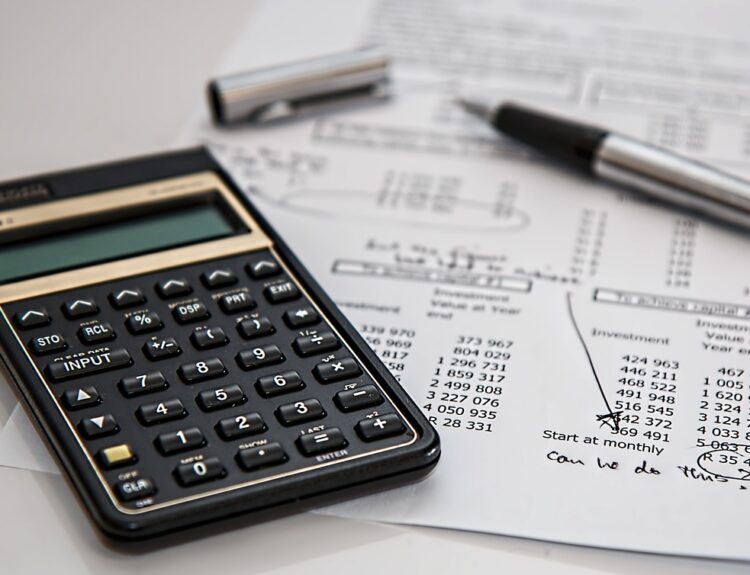Le déficit foncier est un dispositif fiscal destiné aux propriétaires bailleurs. Il permet de réduire la fiscalité en déduisant certaines charges supérieures aux loyers perçus, pas seulement sur les revenus fonciers, mais aussi sur le revenu global, dans certaines limites. En 2025, ce mécanisme reste une solution intéressante pour les investisseurs immobiliers qui souhaitent optimiser la rentabilité de leur bien locatif.
déficit foncier : Qu’est-ce que c’est ?
On parle de déficit foncier lorsque les charges déductibles liées à un bien locatif excèdent les loyers encaissés sur une année. Ce déséquilibre, loin d’être pénalisant, ouvre la possibilité de réduire le montant des revenus fonciers imposables et, au-delà, de venir imputer une partie de ce déficit sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € par an.
Autrement dit, si vous engagez des travaux de rénovation, payez des charges de gestion, d’assurance ou encore la taxe foncière, et que le total de ces dépenses dépasse les loyers perçus, vous générez un déficit qui peut se transformer en économie d’impôt.
⚠️ Ce dispositif n’est accessible qu’aux bailleurs soumis au régime réel d’imposition. Les propriétaires déclarant au micro-foncier (abattement forfaitaire de 30 %) n’y ont pas droit.
Quelles sont les charges réellement déductibles ?
La loi distingue avec précision les charges ouvrant droit au déficit foncier et celles qui en sont exclues, et il est essentiel de bien faire la différence pour éviter toute erreur lors de la déclaration.
Sont ainsi déductibles :
- les travaux d’entretien et de réparation qui visent à maintenir ou remettre le logement en bon état sans en modifier la structure ;
- les travaux d’amélioration destinés à apporter un confort moderne (remplacement d’un système de chauffage vétuste, isolation thermique, mise aux normes électriques) ;
- les primes d’assurance liées à la propriété (assurance propriétaire non occupant, garantie loyers impayés) ;
- la taxe foncière, à l’exception de la part récupérable auprès du locataire ;
- les frais de gestion et de procédure (honoraires de syndic, rémunération d’un administrateur de biens, frais d’avocat) ;
- les intérêts d’emprunt et les frais liés au crédit immobilier, même si leur imputation obéit à une règle spécifique.
En revanche, restent non déductibles les dépenses de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, qui augmentent la valeur du bien, ainsi que certaines charges liées au confort non indispensable (par exemple, l’installation d’une piscine ou d’un ascenseur dans un petit immeuble ancien).
comment fonctionne l’imputation du déficit foncier ?
Le mécanisme se déroule en deux étapes :
- Imputation sur les revenus fonciers : le déficit, y compris les intérêts d’emprunt, vient réduire les loyers imposables. Le revenu foncier peut alors être nul ou négatif ;
- Imputation sur le revenu global : si le déficit dépasse les revenus fonciers, la partie du déficit hors intérêts d’emprunt peut être imputée sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € par an.
Les intérêts d’emprunt ne sont jamais imputables sur le revenu global mais peuvent réduire les revenus fonciers des années suivantes si le déficit excède les loyers perçus.
déficit foncier : Conditions et obligations à respecter
Pour que le déficit foncier soit reconnu :
- Le propriétaire doit opter pour le régime réel d’imposition et déclarer ses revenus via l’annexe n°2044, qui est elle-même jointe à votre déclaration de revenus n°2042 ;
- Le bien doit être proposé en location nue : le déficit foncier n’est pas applicable aux locations meublées (LMNP) ;
- Vous devez conserver toutes les pièces justificatives de vos charges déclarées : factures, plans, photographies ou tout autre document permettant de prouver précisément la nature et le montant des dépenses engagées ;
- Les travaux doivent appartenir aux catégories expressément admises par la loi (entretien, réparation, amélioration).
En bref, le déficit foncier n’est pas seulement un mécanisme fiscal technique, c’est un véritable outil de stratégie patrimoniale : il permet de valoriser un bien immobilier, d’alléger la pression fiscale et de planifier ses investissements sur plusieurs années. À condition de respecter les règles strictes imposées par l’administration et de bien distinguer les charges déductibles, il devient un allié précieux pour tout propriétaire bailleur soucieux d’optimiser la gestion de son patrimoine locatif.